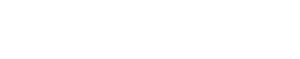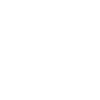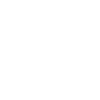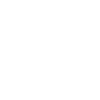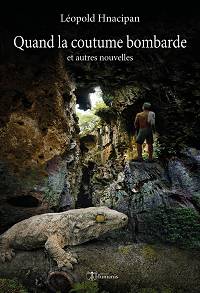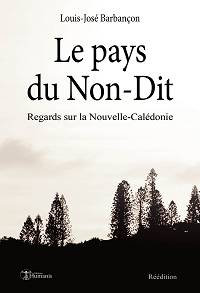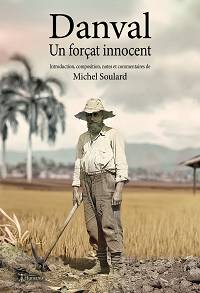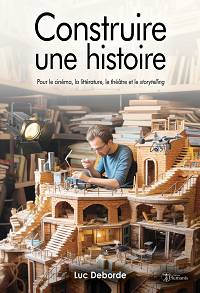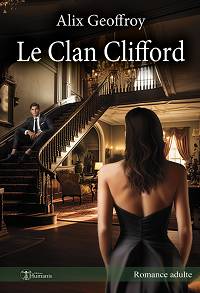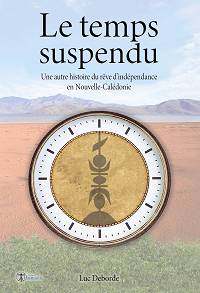Ni trop, ni trop peu...
Qu'il s'agisse du dévoilement d'une intrigue ou d'une simple description, la question du « trop ou trop peu ? » est essentielle.
Sommaire
de cette page :
Comme pour chacune des autres pages de ce site, le discours qui suit est discutable.
Les propositions qui figurent ici peuvent se voir contredites par des exemples
appartenant à la "grande" littérature. Il ne s’agit que de pistes de réflexion.
Ne nous racontons pas d’histoires…
Un livre (même un roman) ne raconte pas une histoire. Il n’en propose que les grandes
lignes. La véritable histoire, celle qui porte du sens et de l’émotion, se construit
dans l’esprit du lecteur. Le livre n’est là que pour exciter l’imagination.
Quand Guillaume Apollinaire nous raconte, dans Les
onze mille verges…
 « C’était
Toné, une jolie brune dont le corps tout blanc avait aux bons endroits, de jolis
grains de beauté qui en rehaussaient la blancheur ; son visage était blanc
également, et un grain de beauté sur la joue gauche rendait très piquante la mine
de cette gracieuse fille. Sa poitrine était ornée de deux superbes tétons durs
comme du marbre, cernés de bleu, surmontés de fraises rose tendre et dont celui
de droite était joliment taché d’un grain de beauté placé là comme une mouche,
une mouche assassine. »
« C’était
Toné, une jolie brune dont le corps tout blanc avait aux bons endroits, de jolis
grains de beauté qui en rehaussaient la blancheur ; son visage était blanc
également, et un grain de beauté sur la joue gauche rendait très piquante la mine
de cette gracieuse fille. Sa poitrine était ornée de deux superbes tétons durs
comme du marbre, cernés de bleu, surmontés de fraises rose tendre et dont celui
de droite était joliment taché d’un grain de beauté placé là comme une mouche,
une mouche assassine. »
… nous a-t-il décrit la donzelle dans le moindre détail ? Ses mots suffisent
pourtant à ce que nous nous en fassions une représentation raisonnablement précise,
grâce à la puissance de notre imagination. Toné a de jolis grains de beauté aux
bons endroits. Hormis celui de la joue et du sein droit, Apollinaire préfère
ne pas les situer.
Elmore Leonard
Si l’auteur s’était contenté d’un « C’était
Toné, une jolie brune. », il est probable que l’image que nous nous
serions créée du personnage aurait été trop floue pour exciter notre imagination.
Mais à l’inverse, s’il s’était lancé dans une description trop précise, il aurait
pris le risque de nous proposer une Toné que nous ne connaissons pas et que nous
aurions finalement été incapables de nous représenter autrement que comme une
image figée, stricte, précise, certes, mais sans émotion. La part de notre imagination
qui recrée Toné d’après les quelques mots d’Apollinaire se nourrit des souvenirs
de demoiselles que nous portons en nous. Aura-t-elle les yeux bleus ? Ses
seins seront-ils généreux ? Sera-t-elle corpulente ou mince comme une liane ?
C’est à nous de choisir parmi la galerie de femmes nues que comportent nos souvenirs.
Et chaque morceau de corps que nous extrayons de notre mémoire pour le plaquer
sur celui de Toné, apporte avec lui son lot d’émotions. Toné sera d’autant plus
convaincante qu’elle sera faite de quelque chose que nous connaissons, de quelque
chose qui nous a émus et qui nous émeut encore, puisque nous le faisons revivre.
Dany Laferrière
Le même genre de question se posera pour n’importe quelle description.
- « Le jardin était séparé de la rue par une grille. » ne nous dit pas grand-chose.
- « Le jardin était séparé de la rue par un portail en fer forgé imposant dont les ornements prétentieux avaient subi les assauts du temps. » en dit déjà assez pour la plupart des lecteurs.
- « Le jardin était séparé de
la rue par un portail en fer forgé imposant dont les ornements prétentieux avaient
subi les assauts du temps. Les diverses couches de peinture qui avaient recouvert
l’ouvrage depuis son installation effaçaient à moitié les motifs gravés que portaient
ses aplats noirs. »
est sans doute excessif. L’afflux de détails, au lieu de préciser l’image,
finit par la noyer et la rendre floue.
Pour réussir ses descriptions, l’auteur doit d’abord accepter les limites autant
que la puissance de son art. Il doit être conscient du rôle majeur que l’imagination
du lecteur jouera dans la représentation de l’histoire. Mais comme nous allons
le voir, la question du "trop, ou trop peu ?" ne s’applique pas seulement aux descriptions.
Nous ne sommes pas là pour juger
Voici un extrait d’un texte de Luc Venot :
« Et ils recommencèrent à rire.
Les enfants veulent juste rire, c’est tout. C’est pour ça que ce sont des enfants. »
Je lui ai suggéré de supprimer la dernière phrase de ce passage. On pourrait aussi imaginer :
« Et ils recommencèrent à rire. N’est-ce pas tout ce qui importe aux enfants ? »
L’auteur doit absolument se garder d’émettre des opinions ou des jugements explicites
qui empiètent sur la liberté de pensée du lecteur.
Billy Wilder
 Comme
je l’exprime déjà sur la page " Comment
faire un bon livre ?
", il s’agit de faire un choix très clair entre roman et essai. Si vous souhaitez
exprimer vos opinions, écrivez un essai ! (Et tâchez d’être rigoureux dans
vos thèses.) Le roman n’est pas fait pour ça. Il est évident que vos convictions
vont guider la construction et le sens de votre histoire et qu’elles vont sans
doute finir par influencer le point de vue du lecteur. Mais vous devez absolument
éviter de les exprimer directement. En dehors du fait que cela manque d’élégance,
vous risquez :
Comme
je l’exprime déjà sur la page " Comment
faire un bon livre ?
", il s’agit de faire un choix très clair entre roman et essai. Si vous souhaitez
exprimer vos opinions, écrivez un essai ! (Et tâchez d’être rigoureux dans
vos thèses.) Le roman n’est pas fait pour ça. Il est évident que vos convictions
vont guider la construction et le sens de votre histoire et qu’elles vont sans
doute finir par influencer le point de vue du lecteur. Mais vous devez absolument
éviter de les exprimer directement. En dehors du fait que cela manque d’élégance,
vous risquez :
- de vous mettre à dos les lecteurs qui ne voient pas les choses comme vous ;
- de vous ridiculiser si vos opinions ne sont pas suffisamment étayées.
Et comment pourriez-vous les étayer, alors que le rythme de l’histoire vous oblige
à éviter les longues digressions ? Même si vous le faisiez, votre position
ne serait pas légitime ! On achète un roman pour son histoire, pas pour se
faire assommer par des discussions oiseuses ;
- de lasser les lecteurs qui voudraient voir avancer l’histoire et qui
se moquent de vos réflexions personnelles ;
- de donner l’impression que vous méprisez le lecteur en réfléchissant
à sa place. N’est-il pas capable de se forger ses opinions et de faire ses déductions
par lui-même ?
Gustave Flaubert
L’écrivain de roman se doit de rester humble et de jouer la neutralité (dans la
forme). Même s’il décrit le parcours d’un serial-killer qui découpe ses victimes
en rondelles, il doit le faire sans parti-pris et sans juger quoi que ce soit. Il
doit faire confiance au lecteur
pour se forger son opinion. Le résultat n’en sera que plus efficace.
Que vos personnages aient des convictions et qu’ils les défendent dans leurs propos,
pourquoi pas ? Mais n’en faites pas trop… Si vous parlez par leurs bouches,
le lecteur s’en rendra rapidement compte.
Dans le roman, en matière de jugements et de discours, on ne risque jamais
d’en faire "trop peu". Seulement "trop".
Dans les dialogues
« Millie le regarda, étonnée.
- Vous ne m’aimez donc pas ?
- Je n’ai jamais aimé les femmes superficielles, cracha John avec dégoût. »
Elmore Leonard
 Le
propos de John ne se suffit-il pas à lui-même ? Est-il vraiment nécessaire
de préciser qu’il « crache » sa phrase ? Après tout, le lecteur
préférerait peut-être qu’il lui « susurre son propos d’un ton méprisant ».
Pourquoi ne pas lui laisser le choix ?
Le
propos de John ne se suffit-il pas à lui-même ? Est-il vraiment nécessaire
de préciser qu’il « crache » sa phrase ? Après tout, le lecteur
préférerait peut-être qu’il lui « susurre son propos d’un ton méprisant ».
Pourquoi ne pas lui laisser le choix ?
À moins que le ton et l’attitude que vous décrivez ne soient absolument essentiels
à la définition d’un personnage ou d’une relation, abstenez-vous autant que possible
et faites confiance à l’imagination du lecteur. Il saura inventer, mieux que vous,
l’attitude du personnage qui aura le plus de sens pour lui.
« Millie le regarda, étonnée.
- Vous ne m’aimez donc pas ?
- Je n’ai jamais aimé les femmes superficielles. »
L’abus d’adverbes et d’adjectifs
Antoine Albalat
Un très grand nombre de textes consacrés à l’art de l’écriture critiquent l’usage
abusif des adverbes et des adjectifs. Il s’agit sans doute d’éviter le "trop".
« John frappa violemment le mur de son poing fermé »
est moins efficace qu’un simple « John
envoya son poing contre le mur »
qui invite le lecteur à se construire son image.
Si vous tentez l’expérience consistant à supprimer la totalité des adverbes de l’un
de vos textes, ne vous arrêtez pas là ! La phrase « John
frappa le mur avec violence »
ne comporte pas d’adverbe. Elle ne vaut pourtant pas beaucoup mieux que « John
frappa violemment le mur »
.
Il me semble que « John envoya
son poing contre le mur »
est préférable parce que cette forme est plus imagée, plus descriptive. Affirmer que John « frappe »
le mur est déjà une interprétation, ou tout au moins une conséquence, de son geste.
En évitant toute forme d’interprétation, à chaque niveau de votre écriture, en
allant vers la description neutre, vous interpellez l’imagination du lecteur sans
l’entraver d’aucune façon.
Émotions versus
sensations
David Morrell
« Millie aimait John follement,
avec passion. Elle l’aimait plus qu’elle n’aimait sa propre vie, plus encore que
son frère ou ses enfants. Plus rien d’autre ne comptait pour elle que cet amour
insensé. Plus rien que lui et lui seul, qui accaparait jusqu’au moindre de ses rêves. »
versus
« À chacun des regards que John
lui lançait, les paumes de Millie se couvraient d’une moiteur qui se répandait
jusqu’aux plus infimes parcelles de son intimité. Elle se voyait peu à peu
glisser vers un gouffre sombre auquel elle ne souhaitait pas résister. »
Votre style personnel décidera du choix que vous ferez entre ces deux formes de
narrations. Pour ma part, il me semble que la description des sensations est toujours
plus efficace que celle des émotions, parce qu’elle est plus proche de la réalité
brute. La description d’une sensation entraîne inévitablement la naissance d’une
émotion chez le lecteur. D’une pierre deux coups ! Alors qu’une émotion livrée
telle quelle ne sera pas forcément partagée. Elle est comme comme "pré-digérée"
et ne comporte plus assez de fraîcheur et de substances nutritives pour aiguiser
l’appétit de l’imaginaire.
Les descriptions d’émotions entraînent souvent des surcharges et des répétitions,
parce qu’il est difficile de leur donner un impact puissant. Elles entraînent
vers le "trop". La description d’une sensation, lorsqu’elle est bien choisie, permet
d’aller vers une concision percutante, mais peut manquer de sens. En cas de doute,
pourquoi ne pas associer les deux ?
« Elle aimait John d’un amour insensé. À chacun des regards qu’il lui lançait, les paumes de Millie se couvraient d’une moiteur qui se répandait jusqu’aux plus infimes parcelles de son intimité. »
Action versus conséquences et interprétations
 « John
envoya son poing contre le mur »
décrit une action. On propose l’image du geste et le lecteur en imagine le résultat.
« John
envoya son poing contre le mur »
décrit une action. On propose l’image du geste et le lecteur en imagine le résultat.
« John frappa violemment le mur de son poing fermé » expose la conséquence de l’action, une fois que le geste est achevé.
« Elle l’aimait plus qu’elle n’aimait sa propre vie. » peut être considéré comme une interprétation de ce que ressent Millie, alors que « À chacun des regards que John lui lançait, les paumes de Millie se couvraient d’une moiteur qui se répandait jusqu’aux plus infimes parcelles de son intimité. » est de l’ordre de l’action. Que Millie mouille sa culotte quand John la regarde est une chose. Qu’elle (ou le narrateur) en déduise qu’elle est amoureuse de John en est une autre. Et à dire vrai, l’expression « Millie mouilla sa culotte » est déjà le résultat de ce qui s’est passé. En décrivant la moiteur qui se répand depuis les paumes de Millie vers les « plus infimes parcelles de son intimité » , la phrase citée en exemple nous raconte le début de l’action. À nous de l’interpréter et d’en tirer les conséquences.
Les scènes les plus percutantes se concentrent sur le début de l’action. Il n’est plus nécessaire d’en dire beaucoup : l’imaginaire du lecteur fait le reste du travail, bien mieux que l’écrivain.
Si l’on compare la littérature française antérieure au vingt-et-unième siècle et la littérature américaine des cent dernières années, on est frappé par la différence de perspective qui les distingue. La première décrit des émotions, des interprétations et des conséquences, alors que la seconde se contente de décrire des actions, sans même prendre la peine, bien souvent, de leur attribuer un sens. Libre au lecteur d’en faire ce qu’il veut.
Trop, ou trop peu d’action ? Trop, ou trop peu d’interprétation ? Voilà
des questions essentielles à vous poser pour chacun de vos textes.
Le lecteur est un partenaire
La question du "trop ou trop peu" concerne directement celle du respect et de la
confiance que l’auteur doit au lecteur. L’écriture idéale est simple, précise,
élégante, humble et neutre dans sa forme (ce qui ne lui interdit pas d’être subversive
dans son fond). Elle reconnaît la capacité imaginative du lecteur, la suscite
et s’appuie sur elle. Et dans le même temps, elle reconnaît son intelligence,
qu’elle nourrit et avec laquelle elle joue. Accessoirement, dans le cadre du pacte qu’il propose à ses lecteurs, l’auteur doit s’interdire de :
- juger les personnages ou leurs actions, prendre explicitement parti pour un personnage ;
- se servir du livre comme d’une tribune, vouloir influencer directement les opinions du lecteur ;
- confondre trop étroitement son style narratif (hors dialogues) avec le parler de ses personnages. Le lecteur sait qu’il est en train de lire un livre ;
- cabotiner, c’est-à-dire faire des clins d’œil au lecteur, jouer la connivence avec lui. Après tout, lecteurs et auteur n’ont pas élevé les cochons ensemble ;
- régler des comptes personnels qui ne concernent pas le lecteur.
À lire aussi sur ce site :
À lire également :
|
|
|

En téléchargement gratuit
Le guide indispensable
des écrivains, scénaristes
et dramaturges

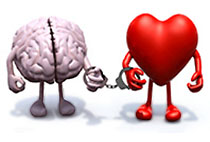

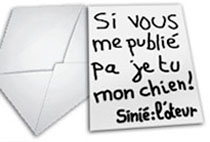

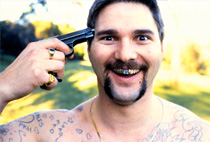

 Les bases
Les bases Pour
aller plus loin
Pour
aller plus loin Notre ligne éditoriale
Notre ligne éditoriale Conseils aux auteurs
Conseils aux auteurs Nos auteurs
Nos auteurs Nos collections
Nos collections Nos nouveautés
Nos nouveautés Meilleures ventes
Meilleures ventes Accueil
Accueil Handicap
Handicap Contact
Contact Rechercher
Rechercher